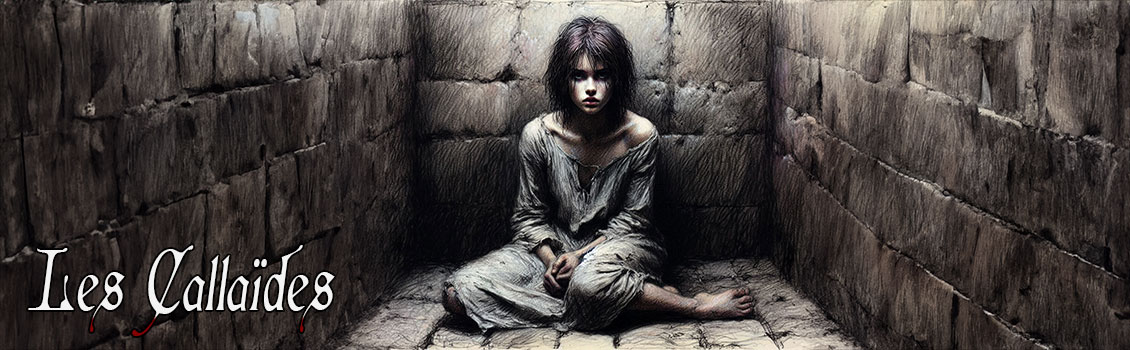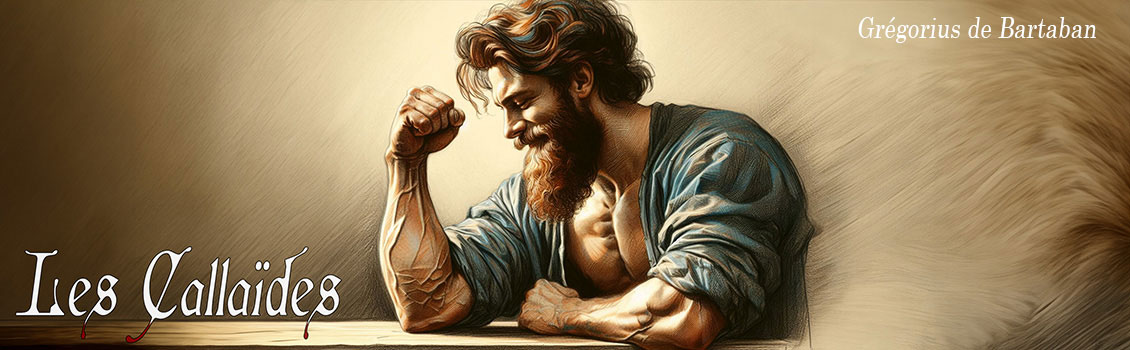Cas n°24 : De certains mots interdits aux femmes
Dans l’usage noble du langage, certains verbes et expressions sont strictement réservés aux hommes, tandis que les femmes doivent recourir à des tournures détournées, plus modestes, adaptées à leur faible condition. Cette convention, qui régit la langue aussi sûrement que l’étiquette dicte les comportements, repose sur l’idée que certaines actions sont naturellement masculines (se battre, boire beaucoup, parler haut…), tandis que d’autres sont féminines (faire la cuisine, broder, allaiter…).
- Le verbe de conquête : un interdit manifeste
Dans la tradition, une femme ne conquiert pas : elle reçoit, attire, se voit octroyer ou encore accepte. Ainsi, là où un homme peut dire :
J’ai conquis la faveur du roi,
une femme devra tourner sa phrase autrement :
Il a bien voulu me faire grâce de sa faveur.
De même, un homme dira :
J’ai conquis cette place de haute lutte.
Alors qu’une femme devra tempérer :
Cette place m’a été accordée à force de persévérance.
L’idée sous-jacente est simple : la conquête implique une prise de pouvoir, une affirmation de soi qui, le lecteur voudra bien l’admettre, sied mal aux femmes.
- Le verbe du commandement : une autorité sous condition
Les femmes ne peuvent pas non plus ordonner ou exiger directement. Une reine ou une noble dame ne dira jamais :
J’ordonne que l’on m’apporte cette missive.
Mais plutôt :
Qu’il me soit apporté cette missive.
Que l’on prenne soin de m’apporter cette missive.
L’interdiction n’est pas absolue : une femme pourra exiger, mais seulement si elle agit en tant que relais d’une autorité masculine. Ainsi, une reine régente pourra dire :
J’exige en vertu du pouvoir qui m’a été confié.
Mais une simple noble ne pourra guère aller plus loin que :
Je souhaite que l’on fasse diligence.
Note : La règle 24 n’est pas terminée ! Nous verrons dans l’article suivant qu’elle régit aussi trois autres cas. En attendant, donnons un chiffre : des érudits ont estimé à 72% le nombre de règles qui ont su prendre racine dans la langue romanienne. Pour les 28% restants, il y a fort à parier que la règle 24 en fasse partie, comme tendrait à la le suggérer l’anecdote suivante…
Un jour, au salon de la reine Catelyne, alors que cette dernière usa du verbe ordonner conjugué à son auguste personne, dame Charis répliqua non sans malice :
— Majesté, il semble que vous ne puissiez ordonner sans offenser la grammaire. On dit qu’une femme peut souhaiter, demander ou prier, mais jamais ordonner, sans quoi le langage en serait tout retourné. De mémoire, c’est la règle n°24 du Précis de romanian qui l’affirme.
La reine Catelyne leva un sourcil, puis répondit d’un ton sec, le regard pétillant de mépris :
— Fort bien. Alors que l’on m’apporte ce grammairien. Je ne lui ordonnerai pas de s’agenouiller, mais je l’inviterai à le faire. S’il refuse, je suggérerai qu’on l’installe à genoux avec toute la courtoisie due à un homme de lettres… Et pour parfaire son éducation, je lui ferai copier cent fois « Une reine ne commande point, mais nul ne lui résiste. » sur les murs de la salle du trône. À la craie. Rose.
Bien entendu, frère Jérôme ne connut pas cette mésaventure. De toute façon, en rédigeant le cas n°24, il se doutait fort bien que c’était là un idéal de langage qui n’avait que peu de chances d’être atteint, ayant eu lui-même l’occasion de remarquer combien les femmes étaient des êtres capricieux avec une volonté autoritaire bien chevillée au corps.